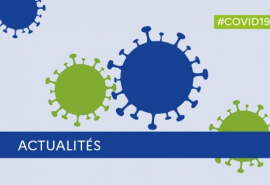Actualités
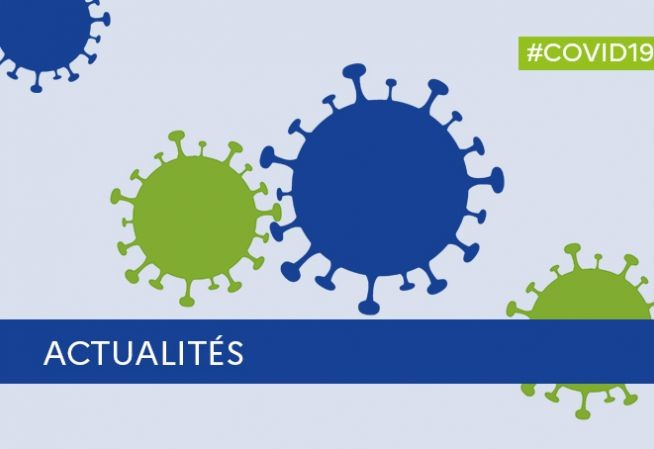
BAIL COMMERCIAL ET COVID-19 : Le droit et l'équité
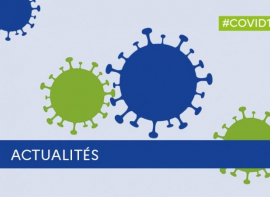









En période d’urgence sanitaire et finalement, d’urgence économique, la pratique semble guidée par un paradigme renouvelé. Aussi, les décisions qui sont actuellement rendues par les juridictions en matière d’impayés locatifs, s’agissant de baux soumis au statut – et de manière générale, de baux d’activité –, tendent toutes à répondre à la même question : la covid-19 justifie-t-elle la suspension des échéances locatives, alors que la réglementation précise, dans le même temps, que les loyers restent exigibles, ce que les juridictions rappellent désormais de manière habituelle.
C’est ainsi que la cour d’appel de Lyon, saisie de l’appel d’une décision rendue le 8 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, s’est prononcée dans le cadre d’un litige relatif à un impayé de loyer commercial.
Pour contextualiser la solution apportée par la juridiction lyonnaise, qui a envisagé un grand nombre de fondements juridiques, il importe de préciser les faits d’espèce.
Tout d’abord, le locataire exploitait un restaurant au terme d’un bail commercial renouvelé en 2012, antérieurement à la réforme du droit des obligations, ce que la juridiction a justement rappelé, s’agissant de la mise en œuvre par le locataire de dispositions qui n’étaient pas applicables à la signature du contrat de bail. Ensuite, le bailleur avait intenté une action en paiement des loyers d’avril, mai, juin et juillet 2020, le locataire ayant unilatéralement suspendu le règlement de ses loyers « durant les mesures de confinement dans l’attente d’une réouverture ». Par ailleurs, le quantum des sommes appelées par le bailleur n’était pas contesté par le locataire, qui s’opposait uniquement à leur exigibilité. En conséquence, et ce n’est pas toujours le cas, la dette locative correspondait en totalité à des arriérés accumulés durant cette période, alors même que rien ne précisait l’éventuelle exploitation d’un espace extérieur ou d’une activité de vente à emporter.
La question était donc de savoir si le locataire opposait des contestations sérieuses de nature à faire obstacle au règlement de ses échéances locatives exigibles entre le mois d’avril et de juillet 2020.
S’agissant de la procédure, le président du tribunal judiciaire de Lyon a considéré que le règlement de ses arriérés de loyers par le locataire ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le condamnant ainsi à régler l’arriéré locatif des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 avec intérêt mensuel de retard de 1,5 %, la somme de 8 833,45 € de pénalité contractuelle outre 3 000 € d’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance. Le locataire, succombant en première instance, interjetait appel de la décision rendue, le 30 septembre 2020. Cependant, la juridiction d’appel rejetait d’une manière particulièrement nette les arguments du locataire, pour confirmer la condamnation en principal, relative au règlement des loyers. Néanmoins, le juge requalifiait en clauses pénales le taux d’intérêt de retard (1,5 % par mois) et la pénalité contractuelle (8 833,45 €), ceux-ci lui paraissant « manifestement excessifs ». La juridiction a ainsi considéré que la demande de règlement des provisions afférentes se heurtait à une contestation sérieuse relevant des pouvoirs du juge du fond.
En droit, le locataire a appuyé son argumentation sur une multitude de fondements qu’il convient d’appréhender dans l’ordre dans lequel ils ont été envisagés, relevant que certains arguments ont été rejetés par la juridiction, qui considérait avoir été saisie d’un fondement légal erroné. Dans un souci de catégorisation des moyens, nous pouvons considérer que le locataire se réfère à trois d’entre eux de manière habituelle (force majeure, perte de la chose et exception d’inexécution), qu’il argue de la bonne foi d’une manière pour le moins originale et qu’un moyen peu envisagé devant juges des référés est évoqué : celui de l’absence de cause.
La force majeure – encore – mise en échec pour défaut d’irrésistibilité ?
Le locataire prétendait que la pandémie, qui caractérisait un événement de force majeure, le dispensait d’avoir à régler ses loyers. Si la cour d’appel de Lyon approuve le locataire en ce que la pandémie est « par essence imprévisible » – même si, selon nous, le caractère imprévisible de l’événement s’appréhende notamment à la date à laquelle les parties ont conclu le contrat de bail –, son irrésistibilité faisait défaut, nécessitant l’appréciation de sa situation financière et comptable, exposé dont ce dernier avait semble-t-il fait l’économie, alors même que le bailleur prétendait qu’il était « partie du groupe Bocuse », valorisé à "100 millions d’euros".
De plus, la cour rappelle que l’obligation pécuniaire est toujours susceptible d’être exécutée (v. par ex. TJ Paris, 17 juill. 2020, n° 20/50920), relevant que de « simples difficultés d’exécution provisoires » ne relèvent pas du régime de la force majeure.
En somme, les deux obstacles habituels à la caractérisation de la force majeure sont bien réunis : d’une part, la force majeure n’est pas invocable s’agissant du règlement de ses loyers par le locataire et, d’autre part, le locataire ne justifie pas du caractère insurmontable de la situation.
Perte des lieux loués : une approche restrictive
L’article 1722 du code civil est un fondement sérieux, que plusieurs juridictions ont récemment mis en œuvre au profit des locataires (v. not. Versailles, 14e ch., 4 mars 2021, n° 20/02572). En l’espèce, la juridiction lyonnaise adopte une posture particulièrement stricte, se limitant à la conception matérielle de la destruction de l’immeuble.
Pour la cour, « l’impossibilité d’exploitation ne [peut] aucunement être assimilée à une destruction sauf à détourner de leur sens les dispositions précitées », avant d’ajouter que le locataire ne peut pas, d’une part, prétendre à la destruction temporaire de ses locaux et, d’autre part, mettre à profit la période de fermeture contrainte de son établissement pour totalement rénover « les terrasses et l’intérieur d’une partie des locaux loués ».
La juridiction paraît considérer que l’utilisation effective des lieux par le locataire, serait-ce pour y réaliser des travaux liés à la destination des locaux, ferait en quelque sorte obstacle à toute perte des lieux loués au titre de l’article 1722 du code civil.
En conséquence, la juridiction lyonnaise ne semble pas souscrire à la lecture de l’article 1722 du code civil consistant à assimiler destruction de l’immeuble et impossibilité d’exploiter.
Bonne foi contractuelle : la présomption s’impose
Le locataire considère que son bailleur aurait agi de mauvaise foi en sollicitant le règlement d’arriérés locatifs, conformément aux engagements qu’il avait pourtant pris au titre du bail. Et que cette prétendue mauvaise foi faisait obstacle aux demandes de règlement formulées devant le juge des référés. Rappelons sur ce point que le bailleur ne remettait pas en cause le lien contractuel, pour se limiter à une demande en paiement. Dans ces conditions, l’on comprend que le locataire souhaitait se prévaloir du courant jurisprudentiel qui considère que certaines circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter l’adaptation par les parties des modalités d’exécution de leurs obligations contractuelles (v. réc. TJ Rennes, 12 mars 2021, n° 20/00829).
La juridiction lyonnaise rejette ses arguments, selon nous, pour deux raisons majeures.
Tout d’abord, si les parties à un contrat doivent se comporter de bonne foi, la mauvaise foi ne se présume pas. En d’autres termes, le fait de solliciter judiciairement l’application d’un contrat valable n’est pas répréhensible. D’autant plus que les loyers restent exigibles au terme de la loi.
La seconde raison s’attache aux faits d’espèce. Il s’avère que le locataire a unilatéralement, dès le 18 mars 2020, notifié la suspension du règlement de ses loyers, sans prendre attache avec le bailleur pour évoquer la situation et éventuellement entamer une négociation en vertu d’éléments objectifs – et notamment, d’éléments comptables – justifiant les difficultés rencontrées. En d’autres termes, et bien que la juridiction n’en fasse pas expressément état, celle-ci a pu considérer que c’était finalement le locataire qui avait agi de mauvaise foi en imposant à son bailleur une modification de ses obligations contractuelles, sans rapprochement préalable.
En conséquence, il est préférable pour les locataires de ne pas suspendre unilatéralement le règlement de leurs loyers, sauf à être dans l’incapacité de se prévaloir des règles de la bonne foi.
Absence ou disparition de la cause ?
S’il existe un moyen qui n’est pas habituellement mis en œuvre devant le juge de l’évidence, il s’agit bien de l’absence de cause, fondée l’ancien article 1131 du code civil. De manière surprenante, la juridiction appréhende le moyen avant de le rejeter, au motif que le contrat court depuis 1997 et que le fonds est exploité depuis cette date, le locataire ayant par ailleurs rénové les locaux « durant la période de confinement ». Ainsi, l’obligation du locataire est régulièrement causée. La prétendue absence de cause arguée par le locataire ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire échec au règlement de ses loyers, même si l’on peut s’interroger sur le fait de savoir si le locataire évoquait une absence de cause ab initio, ou une disparition de la cause en cours de contrat, point qui n’a pas été soulevé par la juridiction.
Défaut de délivrance, exception d’inexécution et maintien dans les lieux
Le locataire prétendait que le bailleur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance et qu’il pouvait dès lors se prévaloir du mécanisme de l’exception d’inexécution pour ne plus régler les loyers afférents à la fermeture contrainte du restaurant. L’on relèvera que des décisions récemment rendues ont pu rejeter les demandes des locataires sur ce point, justifiant parfois leur position par l’absence de faute commise par le bailleur.
Pour rejeter les demandes qui lui ont été soumises, la juridiction rappelle que le locataire était toujours en possession des lieux, qu’il les occupait effectivement, les ayant « rénovés durant la période de confinement ». La cour ajoute que l’impossibilité temporaire d’exploitation ne résultait pas du fait du bailleur, mais des « décisions politiques » prises pour lutter contre la crise sanitaire, « sur lesquelles le bailleur n’a aucune prise ». Bien que les magistrats lyonnais ne l’évoquent pas expressément, nous pouvons raisonnablement considérer que le terme de « décisions politiques » se rapporte à la réglementation d’urgence sanitaire qui a ordonné la fermeture des restaurants.
Il conviendrait alors rapprocher cet arrêt de la décision rendue le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui avait considéré que le bailleur n’était pas responsable d’un défaut de délivrance, en ce que le contenu de cette obligation essentielle ne porte pas sur « la stabilité du cadre normatif » .
En conclusion
En conclusion, s’il reste difficile de dégager quelconque ligne directrice de la présente décision commentée, l’on relèvera néanmoins trois éléments d’importance.
Tout d’abord, le locataire a tout intérêt à justifier de sa situation économique, en soutien à ses demandes. En effet, en l’absence de production d’éléments comptables ou de trésorerie, les juridictions pourraient considérer que les difficultés dont il est fait état devant elles ne sont pas acquises dans leur principe ou dans leur ampleur.
Ensuite, rappelons que le rôle principal du juge n’est pas de modifier le contrat et que la bonne foi contractuelle impose, avant toute chose, de l’appréhender comme tel. La loi ne conditionnant pas l’exigibilité des échéances locatives, c’est un véritable dialogue qui doit s’imposer entre les parties. Dialogue que chacune serait bien avisée d’accepter d’engager, avant toute initiative unilatérale. En effet, si la bonne foi est présumée, le locataire qui suspendrait ses loyers motu proprio risquerait de se voir opposer sa mauvaise foi. De la même manière, le bailleur qui se refuserait à engager un échange préalable avec son locataire pourrait manquer à son obligation de bonne foi.
Enfin, et ce dernier aspect est primordial, aucune ligne directrice ne pourra être tirée des décisions « covid » relatives aux loyers d’activité, sans une prise en compte de la destination contractuelle des locaux, de la date de conclusion des baux, des éventuels aménagements conventionnels convenus entre les parties, s’agissant des dispositions supplétives de volonté – dont la majorité des dispositions du code civil –, de la période concernée par les incidents locatifs et de la typologie des locataires en cause (ceux-ci étant différemment considérés par les dispositions spéciales de la réglementation sanitaire). Partant de ce constat, une étude précise des décisions rendues reste selon nous nécessaire.
- Partager :